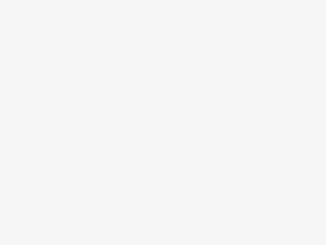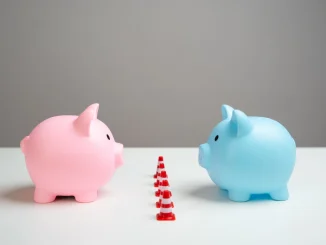
La médiation familiale : une alternative efficace au procès de divorce
Le divorce est souvent synonyme de conflits, de tensions et d’une longue procédure judiciaire. Pourtant, il existe une alternative au procès, permettant aux couples en désaccord de trouver un terrain d’entente sans passer par la […]